
Ma relation avec Jonathan Swift
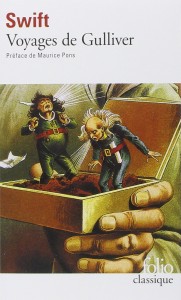 Dans la famille des livres que tout le monde connaît mais qu’on ne lit pas assez, je demande Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift. Un livre que j’adore, qui me fascine, et qui me terrifie. Swift c’est un peu mon parrain, mon tonton flingueur. Je lui dois d’avoir planté en moi la graine du noir et d’y avoir fait germer par le rire, un cynisme amer.
Dans la famille des livres que tout le monde connaît mais qu’on ne lit pas assez, je demande Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift. Un livre que j’adore, qui me fascine, et qui me terrifie. Swift c’est un peu mon parrain, mon tonton flingueur. Je lui dois d’avoir planté en moi la graine du noir et d’y avoir fait germer par le rire, un cynisme amer.
(Présentation subjective, riche en extraits)
Rassurez-vous je ne rentrerai pas dans la biographie du personnage, ni dans les débats pointus de l’exégèse swiftienne, ni dans le travail que les Anglais ont à faire sur l’histoire de la colonisation de l’Irlande. Avec Swift, on n’est proches que par son œuvre. Mais « L’homme est un balai » (1), avouez qu’il fallait quand même la sortir. En prime, il faisait croire qu’il s’agissait d’une très sérieuse méditation de Robert Boyle devant Madame la Comtesse, qui passait pour une conne par la même occasion.
« Mais un balai, direz-vous peut-être, est l’emblème d’un arbre qui se tient sur sa tête ; et je vous prie, qu’est-ce qu’un homme, si ce n’est une créature sens dessus dessous, ses facultés animales perpétuellement montées sur ses facultés raisonnables, sa tête où devraient être ses talons, rampant sur la terre ! Et pourtant, avec toutes ses fautes, il s’érige en réformateur universel et destructeur d’abus, en redresseur de griefs, il va fouillant dans tous les recoins malpropres de la nature, amenant au jour la corruption cachée, et soulève une poussière considérable là où il n’y en avait point auparavant, prenant tout le temps son ample part de ces mêmes pollutions qu’il prétend effacer ; ses derniers jours se passent dans l’esclavage des femmes, et généralement des moins méritantes : jusqu’à ce qu’usé jusqu’au tronçon, comme son frère le balai, il soit jeté à la porte, ou employé à allumer les flammes auxquelles d’autres se chaufferont. »
Swift aimait les canulars, les sarcasmes, les vannes cruelles. Même si on ne l’a jamais lu, son mauvais esprit nous habite, sa répartie éclate de vérités qui font mal. Combien de gens connaissent le Conte du tonneau ? Des quatre voyages de Gulliver, écrits en 1726, on ne retient que le premier, et encore du premier, l’image d’un géant ligoté sur le rivage et encerclé par des lilliputiens. La faute aux adaptations pour enfant ancrées dans nos souvenirs. La faute aussi au plaisir bien compréhensible que les dessinateurs éprouvent en retranscrivant les descriptions fabuleuses contenues dans les textes. Qui pourrait leur en vouloir? Swift, c’est la jouissance du verbe, la phrase en verve, un maître du pamphlet et de l’imagination satirique. Quand ce Rabelais anglais fait pisser un géant sur un palais royal, introduit le débat sur la manière de manger les œufs à la coque au cœur de la lutte des partis, surenchérit sur l’horreur de se livrer à des jeux sexuels avec une géante, ce roi de l’absurde atteint les sommets de la bouffonnerie britannique dont semblent avoir héritée les Montypythons.
- Lisez la description de la machine à sciences spéculatives, qui permet d’écrire tous les systèmes philosophiques possibles, mécaniquement, d’un mouvement de manivelle…
« Le premier professeur occupait avec une quarantaine de disciples une salle de grandes dimensions. Nous nous saluâmes, et, comme mon regard se portait avec intérêt sur une vaste machine qui occupait la pièce dans presque toute sa longueur et sa largeur, il me demanda si je ne trouvais pas ça étrange ses recherches pour faire avancer les sciences spéculatives par les procédés pratiques et mécanisés. Mais le monde verrait bientôt l’utilité de son travail. Il se flattait, quant à lui, d’avoir eu la plus noble idée qui eût jamais été conçue par une cervelle humaine. Chacun sait au prix de quels efforts s’acquièrent actuellement les arts et la science, tandis que grâce à son invention, la personne la plus ignorante sera, pour une somme modique et au prix d’un léger travail musculaire, capable d’écrire des livres de philosophie, de sciences politiques, de droit, de mathématique et de théologie, sans le secours ni du génie, ni de l’étude. Il me fit donc approcher de l’appareil, près des côtés duquel ses disciples étaient alignés. C’était un grand carré de vingt pied sur vingt, installé au centre de la pièce. Su surface était faite de petits cubes de bois, de dimensions variables mais gros en moyenne comme un dé à coudre. Ils étaient assemblés au moyen de fil de fer. Sur chaque face de ces cubes était collé un papier où était écrit un mot en laputien. Tous les mots de la langue s’y trouvaient, à leurs différents modes, temps ou cas, mais sans aucun ordre. Le professeur me dit de faire attention, car il allait mettre la machine en marche. Chaque élève saisit au commandement une des quarante manivelles de fer disposées sur les côtés du châssis, et lui donna un brusque tour, de sorte que la disposition des mots se trouva complètement changée ; puis trente-six d’entre eux eurent mission de lire à voix basse les différentes lignes telles qu’elles apparaissaient sur le tableau, et quand ils trouvaient trois ou quatre mots, qui mis bout à bout constituaient un élément de phrase, ils les dictaient aux quatre autres jeunes qui servaient de secrétaires. Ce travail fut répété trois ou quatre fois, l’appareil étant conçu pour qu’à chaque tour de manivelle, les mots formassent d’autres combinaisons, à mesure que les cubes de bois tournaient sur eux-mêmes… » (P245-246)
Swift le visionnaire, pourfendeur des vices conchie toutes les sociétés humaines.
- Devant le roi de Brobdingnag.
« Il fut complètement ébahi de l’historique que je lui avais fait de nos affaires au cours du dernier siècle. Il n’y voyait, m’affirma-t-il qu’une accumulation de conspirations, rébellions, meurtres, massacres, révolutions, bannissement, le tout n’étant que l’effet désastreux de notre hypocrisie, notre perfidie, notre cruauté, notre rage, notre folie, notre haine, notre luxure, notre malveillance et notre ambition. Sa majesté au cours d’une nouvelle audience, prit la peine de récapituler l’ensemble de ce que je lui avais dit, mettant en regard les questions qu’Elle avait posées et les réponses que j’avais faites. Puis, me prenant dans ses mains et me caressant gentiment, Elle s’exprima en ces termes que je n’oublierais jamais : « Mon petit ami Grildrig, vous m’avez fait de votre pays un panégyrique tout à fait admirable. Vous avez nettement prouvé que l’ignorance, l’incapacité et le vice sont les qualités que vous requérez d’un législateur, et que personne n’explique, n’interprète et n’applique les lois, aussi bien que ceux dont l’intérêt et le talent consistent à les dénaturer par abus. Il ne ressort pas de votre exposé, qu’une seule vertu soit jamais exigée pour l’obtention de vos charges publiques, et encore moins que les prêtres soient promus pour leur piété et leur savoir, les soldats pour leur fidélité ou leur vaillance, les juges pour leur intégrité, les sénateurs pour leur patriotisme et les conseillers pour leur sagesse. Quant à vous, continua le Roi, comme vous avez passé la moitié de votre vie à voyager, je veux bien espérer que vous avez jusqu’à présent su vous garder des nombreux vices de vos compatriotes. Mais d’après les données que m’ont fournies à la fois votre propre récit et les réponses que je vous ai extorquées à grand-peine, je ne puis tirer qu’une conclusion : c’est que les gens de votre race forment, dans leur ensemble, la plus odieuse petite vermine à qui la Nature ait jamais permis de ramper à la surface de la terre. »(P178-179)
- Durant son séjour sur l’île de Glubbdubdrib
« Ce qui me dégouta le plus, ce fut l’Histoire moderne. Car ayant examiné avec grand soin tous les personnages de renom qui avait vécu à la cour des princes pendant les cent dernières années, je compris combien l’opinion a pu être la dupe de ces plumitifs à gages, qui attribuaient les plus grands exploits des guerres à des lâches, les plus sages décisions à des fous, les paroles les plus sincères à des flatteurs, les vertus les plus dignes de Rome à des traîtres ; et qui voyait de la piété chez les athées, de la chasteté chez les sodomites et de la bonne fois chez les faux témoins. Je sus combien d’hommes de bien avaient été condamnés à la mort ou à l’exil, parce que des gens hauts placés s’employaient à corrompre les juges, et à faire jouer la haine de partis ; je sus aussi combien de gredins avaient obtenu les postes les plus élevés dans la confiance des princes, ainsi que le pouvoir, les dignités, les profits, et je vis quelle part immense de tout ce qui se fait et se décide dans les cours, conseils et assemblées revient aux grues et aux cocottes, aux entremetteurs parasites et bouffons. Quelle pauvre opinion ne me fis-je pas de la sagesse et de l’intégrité humaines, quand j’eus la révélation de ce qu’étaient les vrais motifs, les ressorts profonds de toutes les grandes entreprises et révolutions de l’Histoire, et quand je découvris à quelles misères celles-ci devaient leur succès. » (P264)
Swift je t’aime mais je te déteste
Swift, c’est surtout l’écrivain le plus misanthrope que je fréquente. A côté, la ribambelle d’écrits dépressifs, alcooliques ou suicidaires que je lis souvent, n’ont pas fière allure, car ils font en quelque sorte du mépris de l’humanité, une posture de spleen et de déserrance que Swift condamnait tout autant. A l’inverse, il officiait comme pasteur, doyen de la cathédrale de Dublin, moraliste par dessus tout. Je me le représente en réalité comme Gulliver, en bon bourgeois amer et vénéneux, en redingote soignée avec sa montre à gousset, l’oracle de son dieu, le temps. La causticité du ton rend la critique violente et savoureuse. Les visées philosophiques préconisées par le remède, en revanche, m’indignent.
« Mon maître me cita encore un trait particulier, que ses valets avaient découvert chez plusieurs Yahoos, et qui lui paraissait incompréhensible. Il arrive, dit-il qu’un Yahoo prenne une sorte de crise : il va se coucher dans un coin, et se met à gémir, à grogner et à envoyer promener tous ceux qui s’approchent de lui bien qu’il s’agisse d’un sujet jeune et vigoureux, ne manquant ni de nourriture, ni d’eau. Or, les valets n’arrivent jamais à deviner ce qui peut l’affliger ainsi. Le seul remède qu’ils aient découvert, est de le soumettre à un dur travail, ce qui le fait infailliblement rentrer en lui-même. A cela non plus, je ne répondis rien, ne voulant pas prendre parti contre mon espèce, pourtant, je reconnaissais là les symptômes du spleen, ce mal qui n’affecte que les paresseux, les luxurieux et les riches, et que je me ferai fort de guérir, si je pouvais soumettre ses victimes au traitement en question. » P349
Les textes issus des trois premiers voyages ne sont rien au regard de la noirceur du dernier, sur l’ile des Houyhnhnms et des Yahoos. Dans ce pays, les maîtres Houyhnhnms sont des chevaux et les humains dégénérés des esclaves. Une fable à connaître car elle est devenue un archétype culturel. J’oserai avancer que Riad Sattouf ne pouvait pas l’ignorer en réalisant son dernier film Jacky au Royaume des filles, où il met en scène une dictature chevaline. J’insisterai aussi sur le nom du moteur de recherches que des millions d’humains utilisent chaque jour.
Swift pousse ici à l’extrême sa haine de l’espèce humaine. Il dit de l’homme, « Puisqu’une créature se prétendant douée de raison peut commettre de telles abominations, il faut craindre que la corruption de cette faculté ne soit pire que l’animalité elle-même. » La condamnation de l’humanité est absolue. Le portrait des Yahoos inspire la terreur, mais la sagesse des Houyhnhnms qui émerveille Gulliver m’en inspire encore davantage. Orwell n’était pas encore passé par là et l’utopie avait encore cette teinte platonicienne du règne triomphant de la vérité et de la raison. Gulliver rentre chez lui en souhaitant l’extermination des Yahoos. Son drame, c’est de ne pouvoir s’élever à la sagesse chevaline car il n’est lui-même qu’un vil Yahoo. La dépression le guette, la folie aussi, quand le rire nous prend.
« Ma femme et mes enfants m’accueillirent avec beaucoup de surprise et de joie car ils croyaient vraiment que j’étais mort, mais je dois avouer que je ne ressentais à leur vue que haine, dégoût et mépris, surtout quand je considérais combien ils m’étaient proches. Car j’avais beau m’être contraint, depuis mon triste exil du pays des Houyhnhnms, à supporter la vue des Yahoos et la présence de don Pedro de Mendez, ma mémoire et mon imagination restaient emplies des vertus et des idées de ces nobles Houyhnhnms. Et quand il me fallut penser qu’en m‘accouplant avec un individu de l’espèce yahoo j’en avais procréé d’autres, je fus comme assommé de honte, de confusion et d’horreur. Au moment où j’écris, je suis en Angleterre depuis cinq ans. Pendant la première année je ne pouvais supporter la présence de ma femme et de mes enfants : leur seule odeur m’était intolérable ; je ne pouvais encore bien moins souffrir qu’ils prissent leurs repas dans la même pièce que moi. Même aujourd’hui, ils ne s’aviseraient pas de toucher à mon pain ou de boire dans mon verre, et je n’ai jamais consenti qu’on ne me tienne par la main. Ma première dépense fut l’achat d’une paires de jeunes étalons, que j’élève dans une belle écurie. Après eux, c’est le palefrenier qui est mon favori, car je me plais dans l’odeur chevaline qu’il dégage. Mes chevaux ne me comprennent pas trop mal. Je viens parler avec eux au moins quatre heures par jour. Ils ne connaissent ni la bride, ni la selle ; ils me portent beaucoup d’amitié et sont entre eux d’excellents camarades. »
Ce paragraphe n’est-il pas assassin pour sa famille ? Dans Swift, l’amour n’existe pas. Alors Gulliver pour les enfants, essayez un peu pour voir. Dans le meilleur des cas, ils s’endormiront vite, mais si par malheur ils écoutent, allez leur expliquer qu’il faudrait remédier à l’espèce humaine en lui donnant à manger sa merde, qu’il vaudrait mieux pour nous d’être réduits en esclavage par des poneys. Parlez leur de la luxure et de la corruption, dites leur le triomphe systématique du mensonge et du mal. A moins que vous ne vouliez délibérément leur faire peur. Lisez-leur donc « la modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres en Irlande d’être à charge à leurs parents et à leur pays et pour les rendre utiles au public. » Swift y préconise purement et simplement l’infanticide et le cannibalisme, anticipant pour la jeunesse ce que Soleil vert réservait aux vieux quelques siècles plus tard. « Un jeune américain de ma connaissance, homme très-entendu, m’a certifié à Londres qu’un jeune enfant bien sain, bien nourri, est, à l’âge d’un an, un aliment délicieux, très-nourrissant et très-sain, bouilli, rôti, à l’étuvée ou au four, et je ne mets pas en doute qu’il ne puisse également servir en fricassée ou en ragoût. » Avec ça Lautréamont pourrait se racheter une corde. Swift, je t’aime comme un bon pote, on s’installe pour trifouiller dans la boue et cracher sur le monde mais pour ce qui est de le refaire, je vais voir ailleurs, car ta société de chevaux me fait peur, ta raison triomphante et uniformisante me sidère, l’absence de sensibilité me glace dans ta mathématique du langage. Non Swift, je préfère un monde du doute où « la chose qui n’est pas » existe malgré tout.
Lucie servin
( Les extraits sont tirés de l’édition Folio poche, Les Voyages de Gulliver, Swift, traduit et annoté par Jacques Pons d’après l’édition d’Emile Pons et préfacé par Maurice Pons (la famille), Gallimard, 8, 50 euros)
- A méditer, les notions de vérité et de mensonges chez les les Houyhnhnms
« Mon maître m’écoutait, mais je le voyais très mal à l’aise. Car émettre un doute, refuser de croire, est chose si peu connue dans ce pays que les habitants ne savent quelle attitude adopter en pareilles circonstances. Et je me rappelle qu’au cours des nombreux entretiens que j’avais avec mon maître sur la nature de l’humanité dans les autres parties du monde, ayant l’occasion de parler de mensonges, de déformations de la vérité, j’eus toutes les peines du monde à lui faire saisir ce que je disais, bien qu’il eût d’habitude l’intelligence très vive. Car il raisonnait ainsi : la raison d’être de la parole, c’est de nous permettre de comprendre nos semblables et de recevoir des informations sur des faits. Or celui qui me parle dit « la chose qui n’est pas », c’est la nature même du langage qu’il trahit ; car on peut dire alors que je le comprenne, au vrais sens du mot, ou que je reçoive une information, bien au contraire, puisqu’il me laisse dans un état de pire ignorance, et que je suis amené à croire qu’une chose est noire quand elle est blanche ou qu’une autre est courte quand elle est longue. Voilà à quoi se réduisait pour lui la notion de mensonge, alors que la faculté de mentir est si largement connue et utilisée parmi les créatures humaines. »
(1) Lisez la Méditation sur un balai.
Méditation sur un balai.
Ce simple bâton, que vous voyez ici gisant sans gloire dans ce coin négligé, je l’ai vu jadis florissant dans une forêt : il était plein de sève, plein de feuilles et plein de branches, mais à présent, en vain l’art diligent de l’homme prétend lutter contre la nature en attachant ce faisceau flétri de verges à son tronc desséché : il n’est tout au plus que l’inverse de ce qu’il était, un arbre renversé sens dessus dessous, les rameaux sur la terre, et la racine dans l’air ; à présent il est manié de chaque souillon, condamné à être son esclave, et, par un caprice de la destinée, sa mission est de rendre propres les autres objets et d’être sale lui-même : enfin, usé jusqu’au tronçon entre les mains des servantes, il est ou jeté à la rue, ou condamné, pour dernier service, à allumer le feu. Quand je contemplai ceci, je soupirai, et dis en moi-même : certainement l’homme est un balai !
La nature le mit au monde fort et vigoureux, dans une condition prospère, portant sur sa tête ses propres cheveux, les véritables branches de ce végétal doué de raison, jusqu’à ce que la hache de l’intempérance ait fait tomber ses verdoyants rameaux et n’ait plus laissé qu’un tronc desséché. Alors il a recours à l’art, et met une perruque, s’estimant à cause d’un artificiel faisceau de cheveux (tout couverts de poudre) qui n’ont jamais poussé sur sa tête ; mais en ce moment, si notre balai avait la prétention d’entrer en scène, fier de ces dépouilles de bouleau que jamais il ne porta, et tout couvert de poussière, provînt-elle de la chambre de la plus belle dame, nous serions disposés à ridiculiser et à mépriser sa vanité, juges partiaux que nous sommes de nos propres perfections et des défauts des autres hommes.
Mais un balai, direz-vous peut-être, est l’emblème d’un arbre qui se tient sur sa tête ; et je vous prie, qu’est-ce qu’un homme, si ce n’est une créature sens dessus dessous, ses facultés animales perpétuellement montées sur ses facultés raisonnables, sa tête où devraient être ses talons, rampant sur la terre ! Et pourtant, avec toutes ses fautes, il s’érige en réformateur universel et destructeur d’abus, en redresseur de griefs, il va fouillant dans tous les recoins malpropres de la nature, amenant au jour la corruption cachée, et soulève une poussière considérable là où il n’y en avait point auparavant, prenant tout le temps son ample part de ces mêmes pollutions qu’il prétend effacer ; ses derniers jours se passent dans l’esclavage des femmes, et généralement des moins méritantes : jusqu’à ce qu’usé jusqu’au tronçon, comme son frère le balai, il soit jeté à la porte, ou employé à allumer les flammes auxquelles d’autres se chaufferont.
 Follow
Follow